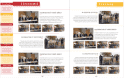La restauration collective attendue sur l’approvisionnement local
Tandis que les produits « de proximité » continuent de séduire une partie des consommateurs, la restauration collective doit jongler entre les attentes sociétales et le respect des réglementations imposées par la loi Egalim. Un jeu d’équilibriste, qui n’est pas toujours évident à trouver et à maintenir. A Lons-le-Saunier, la cuisine centrale a atteint 49 % de produits dits « durables et de qualité ».

Un récent sondage effectué par l’institut Kantar affirme que 61 % des Français « consomment des produits en circuits courts au moins une fois par mois ». Pour 43 % d’entre eux, la principale motivation est « la juste rémunération des producteurs ». Améliorer la rémunération des producteurs et la qualité des produits alimentaires, c’est justement l’objectif que s’est fixé la loi Egalim promulguée en 2018, puis complétée en 2021 par la loi climat et résilience. Parmi ses prérogatives, figure notamment la qualité des repas servis par la restauration collective. Depuis le 1er janvier 2022, ces structures doivent atteindre un taux d’approvisionnement de 50 % de produits « durables et de qualité » (lire encadré), dont 20 % issus de l’agriculture biologique. Mais un problème subsiste. Les produits locaux ou « de proximité » ne répondent pas à la définition d’un produit « durable et de qualité ». Dans ce c...
La suite est réservée à nos abonnés.